Si je devais écrire un guide pour la rédaction des histoires, je le concevrais comme la recette d’une soupe. Une soupe, c’est un mélange homogène. A la regarder, pas moyen de savoir de quels ingrédients elle est faite ; mais qu’on y goûte, et on sentira que chacun d’eux participent à la saveur finale.
Une soupe, c’est aussi un plat distinct, qui a sa place au sein du repas. Personne n’aurait l’idée de manger sa soupe en dessert – sauf peut-être un british, mais ils ont de ces idées, parfois…
Ce que je vais vous apprendre avec cette série d’articles, ça n’est pas comment raconter vos histoires : vous êtes assez grands pour faire vos choix. A la place, je vais vous montrer ce qui se cache derrière vos histoires, à la racine.
Tiens, ça ferait un bon titre ça. Alors venez, explorons ensemble…
Les racines de l’intrigue
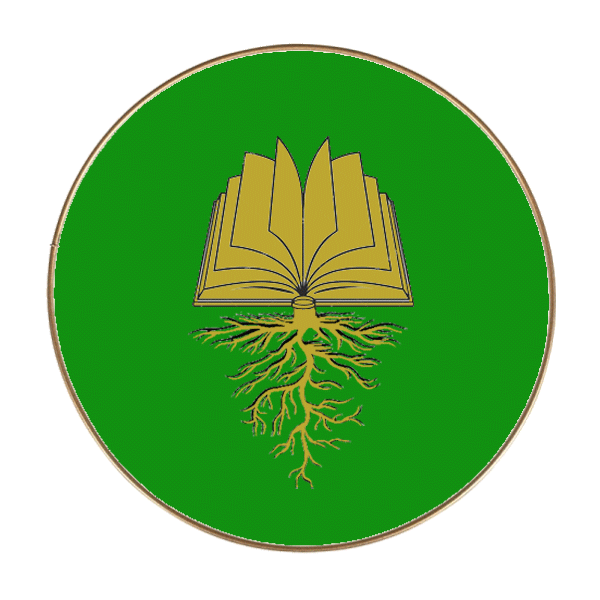
et aujourd’hui, on va déconstruire
Quelques idées reçues
D’abord, la théorie :
Pas rigolo, mais il faut y passer, alors promis on va faire au plus court. La première chose à retenir c’est que, les histoires, on en raconte tout le temps. Sur le plan de la communication, l’anecdote se construit de la même façon que le roman. Ok, la longueur ne va pas être la même, mais dans les deux cas on mettra en place des dispositifs de relance de l’attention, on tâchera de prévoir les réactions de l’interlocuteur : bref, on essayera toujours de l’intéresser, voire de le captiver.
Pour y arriver, on a des structures. Par exemple… vous savez, ce « schéma narratif » dont on a dû vous bassiner au collège ? Celui avec la situation initiale, l’élément perturbateur, les péripéties et tout le bazar ? Oubliez-le. Non, sérieusement. A moins que vous ne vouliez parler des contes de fée russe en tout cas. Déjà, la notion « d’élément perturbateur » n’est valable… et bien, que dans les contes justement (donc c’est vachement spécifique quand même). Ensuite, si vous connaissez le principe des débuts in media res, vous saurez que la situation initiale, on n’en a pas pas besoin non plus. Quant à la « situation finale », on en connaît tous, des œuvres qui s’arrêtent net sans avoir rien expliqué de leur « fin », sans qu’on n’apprenne jamais ce qu’il se passe après une scène capitale. Le cinéma d’horreur le fait par exemple, et pour cause, puisque ça participe au maintien de son effet final.
En narratologie, on parle de « nœud », plutôt que « d’élément perturbateur ». Le nœud est une phase de la narration (contrairement à l’élément perturbateur qui, lui, n’en est qu’un évènement) où l’on va chercher à intriguer son public. Et « intriguer », ça veut tout simplement dire lui faire comprendre que, hey ! Il va se passer un truc qui mérite son attention. Ni plus, ni moins. Du point de vue de l’action, votre nœud peut même être complètement vide.
Exemple :
Ce qu’on aime avec violence finit toujours par vous tuer. Mais comment expliquer ce qui m’arrive ? Comment même faire comprendre que je puisse le raconter ? Je ne sais pas, je ne sais plus, je sais seulement que cela est. – Voilà.
Donc hier – était-ce hier ? – oui, sans doute, à moins que ce ne soit auparavant, un autre jour, un autre mois, une autre année, – je ne sais pas. Ce doit être hier pourtant, puisque le jour ne s’est plus levé, puisque le soleil n’a pas reparu. Mais depuis quand la nuit dure-t-elle ? Depuis quand ?… Qui le dira ? qui le saura jamais ?
Voilà, c’était le nœud de la nouvelle La Nuit de Maupassant. Niveau action, nada. Il ne se passe rien. Par contre, on peut remarquer des bricoles. Sur l’utilisation des interrogatives, sur l’expression du doute du personnage, sur la ponctuation… et sur plein d’autres trucs, en fait ! *
La conclusion, c’est qu’il peut y avoir des nœuds sans action. Et il peut y avoir des nœuds courts, des nœuds longs, des nœuds coulants et… Oops, oubliez pour les coulants. Sérieusement, on en retire un autre point intéressant aussi : c’est qu’en fait le nœud dépend plus de la mise en scène que du contenu. Plus exactement, on dit qu’il en permet la mise en intrigue.
Maintenant, réfléchissons un peu : si le nœud sert à la mise en intrigue (donc, à mettre le public dans le bon état d’esprit en lui signalant qu’on va faire face à des informations importantes), et que la péripétie désigne un évènement… Ouais, la péripétie va avoir besoin de son nœud.
On complique, mais on complète
En fait, la péripétie ne désigne pas n’importe quel évènement : elle correspond à un changement subit et imprévu qui interviendrait dans la narration. Du coup, par définition, la péripétie n’a pas besoin qu’on lui ajoute une phase de nouement : si on la perçoit comme telle, c’est justement parce qu’elle en a déjà une.
Par contre, si on s’intéresse à la structure de l’évènement en général, plutôt qu’à sa spécialisation en péripétie, on se rend compte qu’il y a en a des plus propices que d’autres à une mise en tension. Lorsqu’on menace l’intégrité d’un personnage par exemple, on profite généralement d’un gain d’intensité automatique… Sauf que mise en tension et mise en intrigue, ça n’est pas tout à fait la même chose : autrement dit, sans y mettre les formes, avoir une scène « intense » ne sert pas grand-chose.
Si vous avez compris ça, alors vous comprendrez qu’une péripétie se construit exactement sur le même modèle qu’une histoire complète… On lui consacre moins d’importance, simplement. Réciproquement, l’intrigue, ça n’est jamais qu’une grosse, grosse péripétie, qui va être constituée de plusieurs évènements.
La preuve par la pratique
Pour gérer la mécanique de « quêtes » de l’un de mes prototypes, j’ai eu à bâtir un petit système de génération aléatoire qui passe par des cartes. Elles sont divisées en trois types : les « buts », les « plans » et les « acteurs ». Les « buts » posent l’objectif de l’action, le « pourquoi » qui se cache derrière la demande aux PJs. Les « plans » expliquent comment on veut parvenir à cet objectif, et les « acteurs », enfin, désignent simplement qui sera concerné.
Vous voyez où je veux en venir ? Avec un système de ce type, vous pouvez résumer une histoire entière, à son échelle la plus large. Par exemple, prenons Macbeth. Un but : devenir roi – deux acteurs (mais, schématiquement, mon système les réduit toujours à deux*) : un seigneur et son roi – un plan : l’assassinat… mais vous pouvez aussi déconstruire chaque étape de la narration selon le même schéma.
*d’un autre côté, ce système n’a pas pour ambition de résumer tous les types d’histoire, seulement d’en créer assez pour que le jeu soit intéressant.
Décomposer l’intrigue par petit bout, ça n’est pas une idée neuve. En fait, le concept s’inscrit dans la lignée des 36 situations dramatiques de Georges Polti, des 36 types d’intrigues [dans le jeu de rôle] de Loren J.Miller ou, plus généralement, des travaux de l’école Structuraliste… avec néanmoins une différence dans cette notion de but. Pourquoi est-elle si importante ? On peut écrire un roman avec une série d’actions, de problèmes à résoudre ou, si vous préférez les termes scientifiques, avec une série de situations narratives. Sauf que, sans explication du « pourquoi », sans raison réelle de partir à l’aventure, de commettre un meurtre, ou d’arrêter le méchant voleur qui bloque le pont au villageois, le geste est superflu. Au mieux, il est gratuit. Au pire, il est vide ; et malheureusement dans ce genre de cas, souvent le pire est à prévoir.
L’autre avantage de cette méthode, c’est qu’elle lie d’office les enjeux narratifs (ce que vous avez envie de raconter) avec les enjeux ludiques (le type de défi que vous voulez proposer). Lorsque vous établissez un « but », vous créez un horizon narratif pour vos joueurs. Lorsque vous proposez un « plan », vous posez d’office le cadre pour un type de défi. Mais, dans le jeu de rôle, l’implication du « but » est encore plus utile : par son existence même, il suppose que d’autres manières de faire – donc, d’autres « plans » possibles – existent pour obtenir le même résultat. Par répercuté, ça signifie que vos joueurs disposent, à condition de s’en donner les moyens, d’autres leviers d’actions que ceux que vous leur proposez pour résoudre une situation. Ça signifie aussi que, par flemme ou par sadisme, vous pouvez tout à fait ne donner à vos joueurs qu’un « but », et les laisser trouver par eux-mêmes le plan le plus approprié.
Le résumé
– Une histoire se constitue de situations narrative (de scènes, si vous préférez) intercalées dans le récit général – la narration.
– Ce qui caractérise une situation narrative c’est, plus que toute autre chose, son nouement. Autrement dit, sa phase d’accroche. Dire que le reste est intégralement superflu serait exagéré, mais quand vous repérez un nœud, un moment qui cherche à cristalliser votre attention ou votre tension, vous pouvez être sûr qu’on est passé dans la narration à une situation narrative. Allez vérifier ça sur un film, vous verrez !
PS : en fait, ça n’est pas tout à fait exact : la situation narrative ne sert pas vraiment à relancer l’intérêt de l’interprète, elle sert plutôt à attirer son intérêt sur un élément précis, élément qui normalement est assez intrigant pour raviver sa curiosité. Mais bon, parfois les raccourcis aident à simplifier.
PS² : n’allez pas penser que la narration sert juste de salle d’attente entre deux relances d’intérêt : sans narration, pas d’histoire. Seulement, elle sert à autre chose, à transmettre le ton, l’ambiance, l’esthétique et même, éventuellement, le style.
– Une situation narrative peut se décomposer par un « but », un « plan », et des « acteurs ». Le but, c’est l’objectif général, le « pourquoi » de la scène, ce que l’on veut obtenir, ce à quoi l’on veut échapper, etc. Le « plan », c’est la manière choisie pour satisfaire au « pourquoi », pour atteindre son but. Et les « acteurs », se sont tout simplement les personnages impliqués…
– … Et une histoire en entier peut se décomposer exactement de la même manière, avec un « but », un « plan », et des « acteurs ». Du point de vue de la narration, c’est même pratiquement la même chose – d’ailleurs, c’est bien pour ça qu’on peut, de la même manière, résumer une scène et une intrigue.
– Si vous voulez accroître la liberté de vos joueurs, il suffit de leurs donner des outils pour élaborer leurs propres « plans », plutôt que de les restreindre à celui ou à ceux prévus. Vous pouvez même, éventuellement, leur laisser un « but » sans leur donner de plan… Mais attention à ne pas les perdre, tout de même.
– Et, pour finir, quelques exemples de but et de plans, et une précision sur les acteurs. Ces exemples sont tirés de mon propre prototype, ils sont donc tout à fait orientés, mais ils devraient néanmoins suffire à comprendre la différence d’échelle entre les deux.
- les buts : bénéfice, protection, union, survie, vengeance
- les plans : Elimination, enquête, vol, périple
- mes « acteurs » sont constitués de trois cartes, chacune comportant une information sur leurs récompenses de quête, sur ce qu’ils offrent comme avantage permanent à leurs « amis », et sur la manière de se débarrasser d’eux.
Et ensuite ?
Aujourd’hui, on a surtout parlé de la narration en général, et de manière plutôt théorique avec ça. Demain peut-être, on abordera beaucoup plus pragmatiquement des questions de narrative-design qui concernent le jeu de rôle, sur la manière de créer un type de scénario plutôt qu’un autre notamment. Peut-être même (mais seulement si ça vous intéresse) développerons-nous des questions d’esthétique et de style, sur la manière de créer une atmosphère, de s’intégrer dans un genre, ou de récupérer pour soi la manière de raconter d’un auteur – comme H.P. Lovecraft par exemple !
Après tout, en la matière, tout reste à faire 😉
*Si ça intéresse du monde, maillez moi sur al***********@*****il.fr et je vous filerai l’analyse complète : ça sera plus simple.








Merci beaucoup pour cet article !
Tu donnes quelques techniques pour animer des scènes, mais je serai demandeur de techniques (pour MJ ou joueuses) pour jouer les noeuds. D’après ce que j’ai compris, vu ton exemple de Maupassant, un noeud est un moment métanarratif : le narrateur (qu’il soit un personnage ou non) nous allèche au sujet du récit à venir. Faut-il donc utiliser des techniques de méta-jeu pour appliquer ça en jeu de rôle ?
Hey ! Déjà, merci pour ta question, et pour ton intérêt ! ça va me donner l’occasion de quelques éclaircissements qui auraient sans doute mérité de figurer dès le départ^^ »
En l’occurence, le noeud (ou plutôt, les noeuds) représentent bien des moments, mais ne sont pas limités au méta-narratif : au contraire, ils peuvent prendre plusieurs statuts, en fonction de ce que tu veux en faire :
– comme tu l’as souligné, le métanarratif pur, dans le style des Miles et une nuit ou des nouvelles de Lovecraft : « attendez un peu, et vous verrez que mon récit est digne d’être entendu ». Ce sont des formulations qui 1) sont tenues par le narrateur, qu’il soit intradiégétique (personnage) ou extradiégétique (interlocuteur) 2) qui prennent assez de recul sur leur propre narration pour la considérer comme telle… . Cette technique a pour but de créer une attente, qui est une forme du suspense. Globalement, elle repose sur des stéréotypes (un peu comme un réflexe de Pavlof narratif : on a l’habitude de ces phrases typiques, alors elles nous font saliver d’avance).
Par extension, on peut penser à d’autres éléments si courant qu’ils en deviennent stéréotypiques. Typiquement, le PNJ qui appelle à l’aide entre dans cette catégorie : on a tellement l’habitude de ce genre de choses que, aux yeux d’un joueur, ça revient littéralement à pointer un panneau avec écrit « QUÊTE ! » dessus. D’ailleurs, on note que les MMO ont carrément passé le pas, avec ce système devenu courant de points d’interrogation ou d’exclamation.
– la preuve par l’exemple (ou la mise en pratique artistique de la preuve sociale) : en dépit du caractère fictif des personnages, constater qu’ils accordent de l’importance à certains enjeux appelle, par contamination, l’investissement de l’interprète. L’investissement attendu est ici strictement construit de manière intra-diégétique, ce qui tend à faire de l’interprète le témoin d’une action initiale, elle même conçue pour l’interpeller. Par exemple, on voit des villageois, sans une plainte ni un appel à l’aide, refuser son impôt à un collecteur insensible, et accompagné d’hommes en armes. Aucun doute ne plane : si les PJs n’aident pas, les villageois seront massacrés. Alors, que feront-ils ?
– le doute : cette catégorie-ci est, même si c’est assez contre-intuitif, protéiforme, parce qu’il y a PLEIN de manière de faire douter un interprète. Dans le cadre d’un policier, les éventuelles organisations contradictoires des indices le créent sans peine, mais on peut aussi bien penser au doute sur la survie d’un personnage par exemple. Pourquoi est-ce si efficace ? Parce qu’on rompt tout schéma prévisible, donc ne sachant ce qu’il va se passer, l’avenir peut être investi de toutes les possibilités… dont une seule sera vérifiée.
Toutes ces techniques ont pour effet de pousser l’interprète à s’intéresser sur l’avenir du récit, et lui promettent, de manière plus ou moins implicite, du plaisir s’il poursuit. A titre personnel, je recommanderai tout de même d’éviter le méta à outrance : je ne pense pas qu’un bon conteur ait à sortir de son histoire, quitte à ruiner l’immersion, pour intéresser. Mais bon, ce n’est qu’une préférence personnelle, au fond.
Voilà, j’espère t’avoir répondu !
[…] Cet article a été originellement publié sur D1000&D100 […]